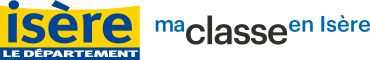Le Lab Junior de retour au collège !
Par MALIKA ZAAKOUR, publié le mardi 13 mai 2025 00:44 - Mis à jour le mardi 13 mai 2025 10:49
Le 02 avril dernier, une nouvelle session des ateliers du Lab Junior a démarré au collège. L’objectif du Lab Junior depuis plusieurs années dans le Réseau Aubrac, développer la curiosité et l’esprit scientifique des écoliers et des collégiens.
A LA DÉCOUVERTE DU PASSÉ GLACIAIRE DE GRENOBLE
Cette année, c’est l’atelier de glaciologie qui a ouvert la saison scientifique. Il a été animé par Lucas Davaze, docteur en glaciologie et climatologie, et Simone Bomchil, professeure de SVT. Ensemble, ils ont proposé aux élèves un voyage à travers le temps pour mieux comprendre l’histoire climatique de Grenoble.
Première étape : direction la Bastille en téléphérique ! Après une randonnée exigeante d’1,5 km jusqu’au Mont Jalla, les élèves ont pu admirer, depuis le belvédère, le panorama. Une belle occasion de réviser la géographie locale avec ses fleuves et ses massifs du Vercors, de Belledonne et de la Chartreuse. Les élèves ont observé les reliefs arrondis du Vercors et de la Chartreuse et les sommets plus élevés et pointus de Belledonne. Pourquoi des reliefs arrondis face à une chaîne de Belledonne plus élevée et pointue ? Lucas Davaze et Simone Bomchil ont donné la réponse : il y a environ 20 000 ans, lors de la dernière période glaciaire, un gigantesque glacier recouvrait l’actuelle cuvette grenobloise. Ce glacier, en avançant et en se retirant, a façonné les paysages. Les massifs arrondis ont été rabotés par la glace, tandis que Belledonne, moins exposée au passage du glacier, a conservé ses crêtes plus abruptes !
Pour illustrer la dynamique glaciaire, Lucas Davaze a eu recours à une expérience simple : il a fait glisser du slime – une pâte visqueuse – dans une gouttière représentant une vallée. Ce modèle a permis de simuler la lente progression d’un glacier. Les élèves ont aussi pu entendre un enregistrement de sons produits par un véritable glacier en mouvement, qui charrie des roches et des débris sous son poids.
QUAND GRENOBLE RESSEMBLAIT AUX BAHAMAS !
Le voyage dans le temps ne s’est pas arrêté là. Grâce à une photo étonnante, Lucas Davaze a fait découvrir aux élèves un paysage de lagon tropical aux eaux turquoises et aux plages de sable blanc. Ce décor paradisiaque correspondait à Grenoble... il y a 130 millions d’années, quand la région était immergée sous une mer chaude !
En redescendant du Mont Jalla, les élèves ont observé les différentes strates rocheuses visibles le long du sentier. Ces couches alternées de roches dures et tendres sont les témoins des sédiments déposés au fond de cette mer ancienne, il y a des millions d’années.
LES ARBRES, TÉMOINS DU CLIMAT
Avant de reprendre le téléphérique, les élèves ont participé à une dernière expérience autour d’un autre indice des variations climatiques : les arbres. Grâce à une tarière, un outil permettant de prélever un échantillon de bois sans abîmer l’arbre, ils ont réalisé un carottage.
Ils ont ainsi pu observer les cernes de croissance : les zones claires, formées au printemps et au début de l’été, quand l’arbre pousse rapidement, et les zones plus sombres, formées à la fin de l’été et en automne, lorsque la croissance ralentit. En comparant la largeur de ces cernes d’une année à l’autre, les élèves ont compris que la croissance d’un arbre varie selon le climat. Des années plus chaudes ou plus humides entraînent une croissance plus forte, tandis que des conditions difficiles la ralentissent. Les arbres gardent ainsi en mémoire les traces du climat passé, et permettent aux scientifiques de mieux comprendre son évolution.
____________________________________________________________________________________________
Ce fut une journée riche en découvertes et révélations scientifiques : apprendre qu'il y a 130 millions d'années, Grenoble ressemblait aux Bahamas ! Les ateliers du Lab Junior vont se poursuivre jusqu'en juin prochain, les mercredis après-midis, grâce à la médiation et l'engagement de chercheurs et de scientifiques passionnés.
NB : un grand merci à Simone Bomchil pour sa précieuse collaboration scientifique à la rédaction de cet article.